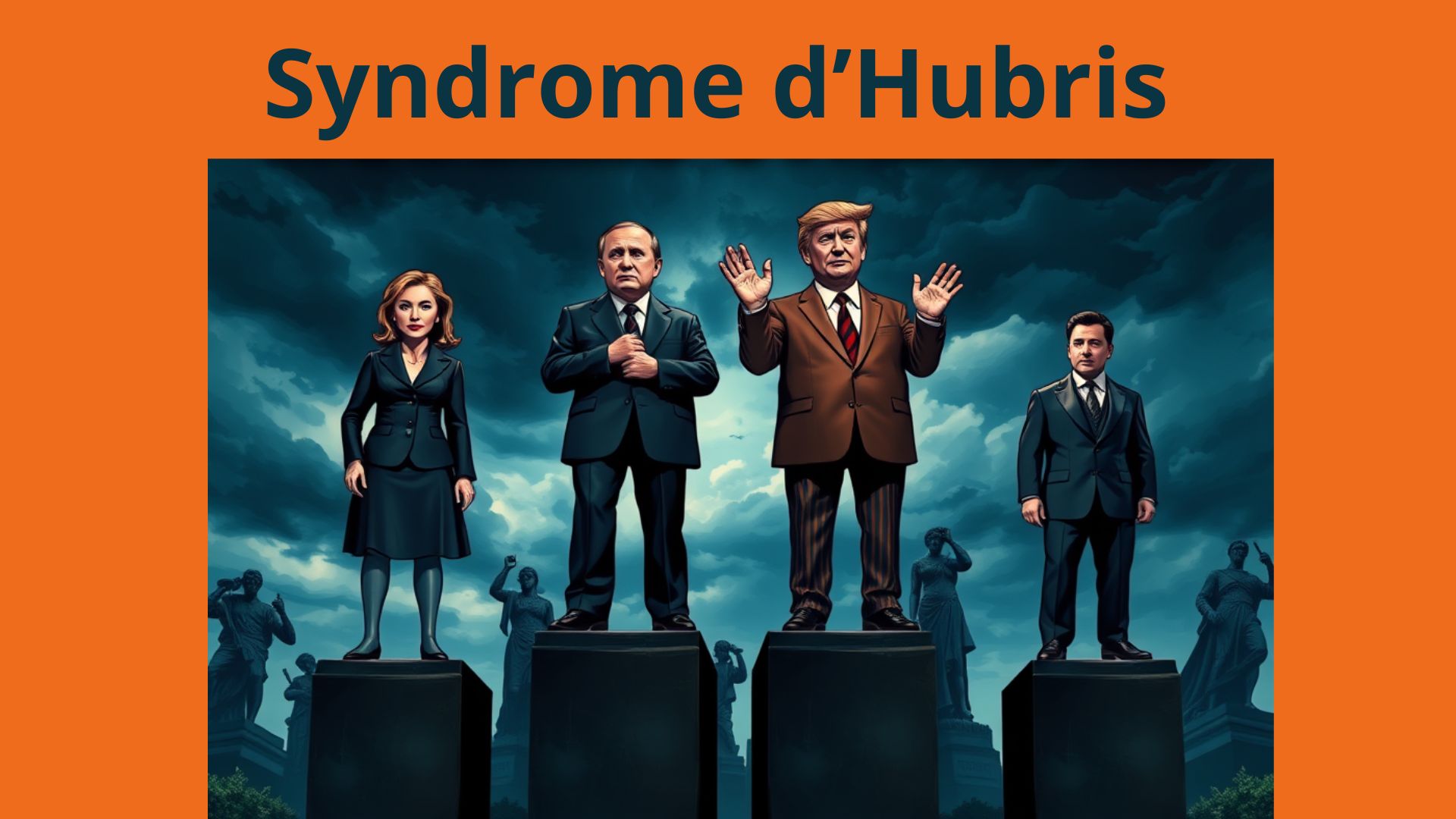Introduction
Le pouvoir transforme-t-il ceux qui l’exercent ? Le syndrome d’hubris (SH), conceptualisé par David Owen, médecin et ancien ministre britannique, et Jonathan Davidson, psychiatre, dans leur article de 2009 (Brain), offre une réponse troublante : un pouvoir prolongé peut engendrer un trouble psychologique acquis, marqué par une confiance excessive, de l’imprudence et le mépris d’autrui. Popularisé par cet article et enrichi par des travaux comme ceux de Peter Garrard et al. (Cortex) sur les biomarqueurs linguistiques, le SH se distingue des pathologies classiques par son caractère contextuel : il émerge avec l’autorité et s’estompe souvent après sa perte. Dans « Le pouvoir rend-il fou ? » (2019), Erwan Devèze, consultant en neuroleadership, complète cette analyse en explorant les altérations cérébrales sous-jacentes, notamment dans les circuits dopaminergiques et préfrontaux, qui amplifient ces dérives. Cet article examine le cadre théorique du SH, ses manifestations cliniques, les preuves empiriques et ses implications, avant d’analyser des cas contemporains : Donald Trump, Elon Musk, Vladimir Poutine et Marine Le Pen.
Définition
Dans la Grèce antique, l’hubris était considéré comme le péché capital par excellence, une faute grave qui consistait à se hisser au rang des dieux ou à défier leur autorité par un excès d’orgueil. Cet acte d’arrogance était perçu comme une transgression des limites imposées aux mortels, rompant l’équilibre entre l’humain et le divin. Les Grecs croyaient que l’hubris attirait inévitablement la colère des dieux, qui voyaient cela comme une menace à leur suprématie. En conséquence, un châtiment était infligé, souvent sous la forme d’une némésis, une punition divine visant à rétablir l’ordre et à rappeler à l’homme sa condition mortelle. Des figures mythologiques comme Icare, qui vola trop près du soleil, ou Tantale qui vola aux dieux le nectar et l’ambroisie, illustrent parfaitement les conséquences tragiques de l’hubris.
Owen et Davidson (2009) le redéfinissent comme un syndrome acquis, déclenché par un pouvoir substantiel, surtout lorsqu’il s’accompagne de succès marquants et de peu de contraintes. Distinct des troubles narcissiques ou antisociaux, ancrés dès l’enfance, le SH amplifie des traits préexistants – autosuffisance, impulsivité – après l’accès au pouvoir. Devèze (2019) précise que cette transformation s’enracine dans une suractivation des circuits de la récompense (dopamine) et une désinhibition du cortex préfrontal, altérant la prise de décision. Keltner et al. (2003) parlent d’un « paradoxe du pouvoir » : l’autorité réduit l’empathie et accroît la surconfiance. Réversible, le SH s’atténue souvent hors du pouvoir. Il est probablement plus juste de le considérer comme un changement contextuel de la personnalité plutôt que comme une pathologie chronique. Des succès répétés ou des crises majeures – guerres, crises économiques – en accélèrent l’apparition, touchant aussi bien les leaders démocratiques que dictatoriaux.
Description clinique
Owen et Davidson listent 14 symptômes, dont trois au moins, incluant un symptôme unique, sont requis pour diagnostiquer le SH :
- Une vision narcissique du monde comme arène de gloire (symptôme repris dans le trouble de la personnalité narcissique – TPN.6[1]).
- Des actions visant à polir son image (TPN.1).
- Une obsession pour l’apparence (TPN.3).
- Un discours messianique exalté (TPN.2).
- Une fusion des intérêts personnels avec ceux de la nation (unique).
- L’usage du « nous » royal ou de la troisième personne (unique).
- Une confiance excessive, méprisant conseils et critiques (TPN.9).
- Une croyance en une quasi-omnipotence (TPN.1 et 2).
- Une responsabilité envers une instance supérieure (Histoire, Dieu ; TPN.3).
- Une justification par cette instance (unique).
- Une déconnexion de la réalité par isolement (trouble de la personnalité antisociale -TPA.3 et 5).
- Une impulsivité et une imprudence (unique).
- Une rectitude morale ignorant les coûts pratiques (unique).
- Une incompétence hubristique par excès de confiance (trouble de la personnalité histrionique -TPH.5).
Sept symptômes recoupent le narcissisme (TPN), deux les troubles antisociaux (TPA) et histrioniques (TPH), mais cinq sont spécifiques.
Le syndrome d’Hubris éclaire les fragilités du pouvoir, mais sa distinction avec le TPN reste débattue. Le SH est rarement traité, les leaders y voyant une force. Robertson (2012) le lie à la testostérone et à la dopamine, réduisant l’empathie, un point corroboré par l’impulsivité mesurée par Garrard et al. Pour Devèze, ces comportements reflètent une « intoxication dopaminergique », où le pouvoir agit comme une drogue, renforçant l’addiction à la domination. Il voit le SH comme une « pathologie neurocomportementale » méritant une reconnaissance clinique, bien que des études longitudinales manquent.
4 figures contemporaines du syndrome d’Hubris : Donald Trump, Elon Musk, Vladimir Poutine et Marine Le Pen
Appliquons le concept d’Hurbis à quatre figures contemporaines – Donald Trump, Elon Musk, Vladimir Poutine et Marine Le Pen – en analysant leurs comportements publics. À travers leurs discours et décisions récentes, examinons comment le pouvoir amplifie leurs traits hubristiques, tout en discutant des limites de ce diagnostic sans évaluation clinique.
Donald Trump
Donald Trump, redevenu président des États-Unis en janvier 2025 après sa victoire de novembre 2024, illustre plusieurs marqueurs du SH :
- Confiance excessive et glorification personnelle : Lors d’une interview avec Elon Musk sur Fox News (février 2025), Trump a vanté le « respect » de leaders comme Poutine, présentant l’enquête sur l’ingérence russe comme une « chasse aux sorcières » surmontée par sa grandeur (NPD.6).
- Imprudence et impulsivité : Sa rencontre avec Volodymyr Zelensky (février 2025) – moquant l’Ukrainien avant de rejeter l’aide à Kiev pour un cessez-le-feu pro-Poutine – montre une décision unilatérale, critiquée par l’OTAN (symptôme 12).
- Mépris des conseils : Ignorant les républicains modérés, Trump a revendiqué dans The Atlantic (février 2025) que sa relation avec Poutine garantit la paix, signe d’une foi aveugle en son jugement (NPD.9).
- Contexte : Son retour au pouvoir, soutenu par Musk et un Parti républicain affaibli en contre-pouvoirs, amplifie ces traits, exacerbés par un premier mandat (2017-2021). Devèze souligne que cet environnement de loyalistes favorise une « dérive neurocomportementale ».
Elon Musk
Elon Musk, milliardaire influent et conseiller de Trump via le Department of Government Efficiency (DOGE) depuis novembre 2024, incarne une hubris techno-financière :
- Surconfiance et omnipotence : En mars 2025, Musk a exigé des employés fédéraux une justification de leur poste en 48 heures (NDTV), une directive ignorée par le FBI et le Pentagone, reflétant une croyance en sa capacité à réformer seul (NPD.1 et 2). Robert Zubrin (X, 30 mars 2025) y voit une « ivresse de pouvoir » cherchant la « gloire éternelle ».
- Actions pour l’image : À Green Bay (CNN, mars 2025), il a distribué des chèques d’un million de dollars pour un juge conservateur, renforçant son image messianique (NPD.3).
- Mépris des contraintes : Malgré des avertissements légaux (PBS News), Musk persiste dans ses dons électoraux, qualifiant ses critiques d’« enragés » sur Fox News (février 2025 ; symptôme 7).
- Contexte : Sa fortune, son contrôle de SpaceX et X, et son rôle auprès de Trump réduisent les freins à ses ambitions.
Vladimir Poutine
Vladimir Poutine, au pouvoir depuis 2000 (avec une parenthèse comme Premier ministre, 2008-2012), offre un cas d’hubris institutionnalisée :
- Croyance messianique : En novembre 2024, félicitant Trump, Poutine a proclamé la fin de l’ordre libéral (Vanity Fair), se posant en sauveur de la « sainte Russie » face aux « Nazis » ukrainiens (France-Amérique ; symptômes 4 et 9).
- Imprudence géopolitique : L’invasion de l’Ukraine (2022-2025), prolongée malgré des pertes colossales, montre une obstination hubristique (symptôme 12), rejetant toute négociation (RTL, mars 2022).
- Mépris et isolement : Entouré de loyalistes, il ignore critiques internes et occidentales (Jerusalem Post, 2022), utilisant parfois la troisième personne (symptôme 6).
- Contexte : Après 25 ans de règne, son pouvoir autocratique et ses succès passés (Crimée, 2014) renforcent une déconnexion de la réalité.
Marine Le Pen
Marine Le Pen, leader du Rassemblement National (RN) depuis 2011 et condamnée en mars 2025 pour détournement de fonds, présente une hubris populiste :
- Confiance excessive et glorification : Après sa condamnation (31 mars 2025) à quatre ans de prison (dont deux ferme sous bracelet) et cinq ans d’inéligibilité (The Guardian), elle a dénoncé une « décision politique » sur TF1, se posant en martyr soutenue par « le peuple » (NPD.6).
- Imprudence et impulsivité : Son déni dans l’affaire des assistants parlementaires (Le Monde, 1er avril 2025), malgré des preuves, a aggravé sa peine, interdisant sa candidature en 2027 (symptôme 12). Ses choix tactiques incohérents (censure de Barnier, soutien à Bayrou) reflètent une impulsivité stratégique.
- Mépris des conseils : Ignorant Jordan Bardella sur une succession post-condamnation (Le Monde, 1er avril 2025), elle refuse de céder, renforçant l’incertitude au RN (NPD.9).
- Style messianique : Se présentant comme sauveuse de la France, elle fusionne son destin avec celui de la nation (« la démocratie tuée », via Bardella ; symptômes 4 et 5).
- Contexte : 14 ans de leadership et un isolement progressif (expulsion de son père en 2015) ont amplifié ces traits.
Comparaison et Discussion
Ces leaders partagent surconfiance, impulsivité et focalisation sur l’image, mais leurs contextes diffèrent :
- Trump mêle narcissisme et réactivité, exacerbées en 2025.
- Musk incarne une hubris techno-financière, nourrie par son influence sur Trump.
- Poutine illustre une hubris autocratique de longue date.
- Le Pen reflète une hubris populiste, limitée par des institutions démocratiques.
Leur dynamique triangulaire – admiration Trump-Musk, contacts Musk-Poutine (WSJ), influence Poutine-Trump (Mother Jones) – pourrait amplifier leurs excès. Chez Le Pen, un narcissisme préexistant et sa condamnation compliquent le diagnostic, mais son déni post-2025 aligne ses traits sur le SH.
Conclusion
Le syndrome d’hubris révèle comment le pouvoir altère le cerveau et le comportement. Trump, Musk, Poutine et Le Pen, en 2025, incarnent des facettes du syndrome d’hubris : décisions unilatérales, mépris des limites, glorification personnelle. Leurs comportements publics suggèrent une ivresse du pouvoir mesurable, bien que spéculative sans données cliniques.
Dans le prochain article, nous analyserons, du point de vue de la psychologie, la complicité citoyenne face à l’ivresse de pouvoir des dirigeants.
Bibliographie
- Devèze, E. (2019). Le pouvoir rend-il fou ? Enquête au cœur du cerveau de nos dirigeants. Paris : Larousse.
- Garrard, P., et al. Linguistic Biomarkers of Hubris Syndrome. Cortex.
- Keltner, D., et al. (2003). Power, approach, and inhibition. Psychological Review, 110(2), 265-284.
- Owen, D., & Davidson, J. (2009). Hubris syndrome: An acquired personality disorder? Brain, 132(5), 1396-1406.
- Robertson, I. H. (2012). The Winner Effect. Bloomsbury.
- The Atlantic, CNN, Fox News, The Guardian, Le Monde, NDTV, PBS News, Politico, Vanity Fair, WSJ (articles cités, 2022-2025).
- Traclet, A. (2023). Hubris syndrome revisited. Psychological Medicine, 53(13), 1-7.
- Vincze, A., et al. (2022). Linguistic markers of power. PLOS ONE, 17(8), e0271234.
Articles de la série
« Le Pen, Poutine, Trump, Musk : le syndrome d’Hubris ou l’ivresse du pouvoir » : https://www.resilience-psy.com/le-pen-poutine-trump-musk-le-syndrome-dhubris-ou-livresse-du-pouvoir/
« Complicité citoyenne face à l’ivresse de pouvoir des dirigeants : une analyse psychologique du syndrome d’hubris « : https://www.resilience-psy.com/complicite-citoyenne-face-a-livresse-de-pouvoir-des-dirigeants-une-analyse-psychologique-du-syndrome-dhubris/
[1] L’usage des numéros (TPN.1, NPD.6, etc.) sert à établir une correspondance claire entre les symptômes du SH et ceux du TPN, permettant une analyse comparative. Les numéros correspondent à l’ordre de ces critères dans le DSM-5).
#SyndromeDHubris #Pouvoir #Psychologie #ConfianceExcessive #Narcissisme #ElonMusk #DonaldTrump #VladimirPoutine #MarineLePen #Leadership #Neuroleadership #ComportementHumain #Politique #Hubris #Réflexion #Société